Le Musée d’art de Joliette a pour mission d’acquérir, de conserver, de mettre en valeur et de diffuser des œuvres anciennes et contemporaines d’artistes québécois, canadiens et étrangers au moyen d’expositions et d’activités culturelles et éducatives.
La collection du Musée d’art de Joliette est aujourd’hui composée de huit mille cinq cents œuvres réparties en quatre collections : art canadien, art européen, art contemporain et archéologie. La politique d’acquisition ou de documentation du Musée, de même que ses nombreuses collaborations avec d’autres institutions du Québec, du Canada et de l’étranger, lui permettent d’atteindre ses objectifs de conservation de sa collection et de demeurer extrêmement dynamique sur le plan de la recherche.
S’adressant à un public de tous les âges, le Musée d’art de Joliette inscrit ses actions dans une démarche de démocratisation culturelle visant à rendre accessibles les connaissances émergentes dans le domaine des arts visuels. La diffusion de ces connaissances se concrétise par la mise sur pied d’expositions permanentes et temporaires ainsi que par la publication de catalogues, la mise en circulation d’expositions, la réalisation de projets hors les murs, le prêt d’œuvres d’art et un programme de visites commentées et d’activités éducatives et culturelles (conférences, rencontres-causeries, concerts, lectures publiques et voyages culturels).
Ces espaces du possible enfouis en nous sont obscurs parce que anciens et cachés; ils ont survécu et se sont renforcés grâce à cette obscurité. Au cœur de ses profondeurs, chacune d’entre nous tient entre ses mains une réserve époustouflante de créativité et de puissance, d’émotions et de sensations vierges et inexplorées. – Audre Lorde
Que peut l’art face à l’adversité du monde?
C’est en explorant cette question, vaste et récurrente, que ce projet d’exposition a pris forme. Si l’art ne peut réparer le passé ni guérir le réel, force est d’admettre que sa nécessité vitale a maintes fois été formulée à travers le temps. «La poésie n’est pas un luxe», affirmait en ce sens la poétesse et militante queer afroféministe Audre Lorde. Pour elle, la poésie est un espace de transformation, le levier d’une conscience libre, d’où peuvent jaillir des désirs et des espoirs, là où l’intime rejoint le politique.
Dans cette perspective, La clarté creuse les montagnes réunit le travail de huit artistes qui investissent le potentiel poétique de la création comme un espace d’émancipation. De la poterie à l’installation, en passant par la peinture, le tissage, la performance et la vidéo, les œuvres présentées articulent une portée politique qui se manifeste autant dans les choix formels et matériels que dans le propos qu’elles sous-tendent. Puisant dans des mémoires familiales et collectives (nêhiyaw, palestinienne, haïtienne), s’inspirant d’expériences, de révoltes et de savoir-faire traditionnels, les œuvres révèlent des imaginaires libres, rebelles et indociles. Les gestes plastiques et la quête de beauté s’incarnent ainsi, dans la démarche des artistes, en une posture de résistance face aux systèmes hégémoniques qui contraignent les vies et les imaginaires.
À une époque trouble, où l’effondrement de l’ordre mondial rend visibles des violences longtemps ignorées, le champ du sensible constitue un espace de lutte essentiel. Ouvrir des brèches, modeler des possibles, faire surgir d’autres manières d’être au monde. L’exposition envisage l’art comme un espace de déplacement, un lieu de friction où se déploient des formes capables, ne serait-ce qu’un instant, de creuser les montagnes.
Commissaire : Ariane De Blois
*Le titre de l’exposition s’inspire du premier vers du poème Shipiss de Marie-Andrée Gill.
Artistes : asinnajaq, Nathalie Batraville, Stina Baudin, Amanda Boulos, Berirouche Feddal, Shannon Garden-Smith, Frantz Patrick Henry et Tyson Houseman.
Dès le 7 février.
Pour plus d'infos, cliquez.
Une version légèrement déformée de la célèbre chanson Like a Virgin de Madonna résonne tandis qu’une cryptoballerine et trois sirenas – des humanoïdes futuristes vêtues de costumes colorés et à motifs – dansent sur une plage de galets au bord d’un lac volcanique. Leur chorégraphie, à mi-chemin entre une performance de drag et un vidéoclip postapocalyptique, est chaotique, cacophonique et déroutante, mais aussi étrangement séduisante et envoûtante. Des bitcoins pleuvent du ciel, déclenchant twerks et cris de plaisir.
Bienvenue à la rencontre entre moiteur et cryptominage
Formé par Anna Ehrenstein, Alexa Evangelista, Sunny Pfalzer et Lucy Tomasino, Cripto Sirenas est un collectif temporaire engagé dans ce qu’elles décrivent comme une démarche de création d’univers de science-fiction et multimédia visant à spéculer sur le technosolutionnisme, les algorithmes totalitaires et les effets de ces réalités émergentes sur nos corps et nos environnements. Ancré dans une vision hydroféministe du monde, leur travail se concentre sur l’eau, la fluidité et la moiteur, envisagées comme un vecteur incarné de résistance aux systèmes contemporains et futurs d’oppression et d’exploitation qui imposent la rigidité, la binarité et la catégorisation. Dans des cadres fabuleux et oniriques – allant de monuments urbains publics à des milieux naturels aquatiques isolés –, le projet met en lumière la manière dont les modèles économiques et extractivistes reposent sur des formes de cryptocolonialisme issues de l’Ancien Monde, qui menacent de hanter les mondes à venir.
Ce paysage multimodal peuplé de ballerines cyborgs a pour pièce centrale une projection vidéo à trois cent soixante degrés, issue d’un processus d’écriture somatique qui plonge le public dans un récit captivant. L’installation reformule et repense la médiatisation des corps des artistes à travers divers artéfacts. Des éléments bidimensionnels – papiers peints aux motifs éclatants, collages percutants et photographies abondamment retouchées – servent d’écrin aux composantes sculpturales et aux prolongements de leur présence performative, disséminés dans l’espace. Des conversations théoriques filmées avec le chercheur Web3 Josh Davila se mêlent à une écologie organique qui conjugue le numérique et le physique, le réel et le plus-qu’irréel, l’humanoïde aux fuites et aspérités et la perfection lisse du calculateur central. Multipliant leur présence, Anne Ehrenstein, Sunny Pfalzer, Alexa Evangelista et Lucy Tomasino proposent une œuvre en constante évolution, plongeant leur public dans un cycle de brassage d’informations, d’affects et de mouvements – un autel vivant et un manifeste pour des futurs moites.
Commissaire : Didier Morelli
Artistes : Anna Ehrenstein et Sunny Pfalzer, avec Alexa Evangelista et Lucy Tomasino.
Dès le 7 février.
Pour plus d'infos, cliquez.
Les îles réunies est l’exposition permanente du Musée d’art de Joliette. Rassemblant une centaine d’œuvres de la collection, cette présentation ne dispose d’aucune contrainte chronologique ou thématique. L’exposition met en relation tant des œuvres du XIVe siècle que des installations récentes. À travers les différentes disciplines des arts visuels, des créateurs tels Paul-Émile Borduas, Isabelle Hayeur, Ozias Leduc, et Guido Molinari y sont représentés et s’y donnent la réplique.
La magie de cette exposition réside dans le pouvoir d’interpellation des œuvres entre elles. Un détail d’une sculpture pourra, par exemple, trouver une correspondance dans une photographie disposée à proximité. Toute la finesse de la mise en espace et du jeu muséologique pourra y être admiré. Les îles réunies vous convie donc à une rencontre éphémère du passé et de l’actuel, dans un choc de sens et de significations.
Pour plus d’infos, cliquez.
Réalisée dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture, Collections, le temps suspendu est une installation de l’artiste multidisciplinaire Claudie Gagnon. Fixée au-dessus de l’escalier qui mène au toit du Musée, l’œuvre se compose de centaines d’objets en verre et en cristal. Suspendue à une plaque d’acier inoxydable polie, l’installation est rehaussée par un effet miroir saisissant. À la tombée de la nuit, Collections, le temps suspendu demeure visible de la rue, puisqu’un éclairage a été conçu en conséquence. Vue de loin, elle produit une nuée scintillante qui varie au gré de la lumière naturelle. Admirée en proximité, elle laisse place à l’observation de fins détails.
Mise en abîme de la fonction première du musée, Collections, le temps suspendu rassemble des centaines d’objets de brocante qui rappellent des artéfacts trouvés dans des cabinets de curiosités d’un autre temps. Les pièces ainsi regroupées sont issues de différents pratiques et métiers dont les sciences et les arts. Comme s’ils étaient figés dans le temps, ces objets composent une œuvre ludique qui interpelle l’imaginaire.
Pour plus d’infos, cliquez.
Cette exposition en salle est une reconfiguration d’une exposition virtuelle éponyme qui, dans sa forme originale, propose une lecture féministe de quatre-vingts ans (1942-2022) d’existence du Musée d’art de Joliette (MAJ) à travers quatre-vingts œuvres de sa collection permanente. Ce reploiement en mode plus intimiste au Musée agit comme contrepoids à la composition de la collection, qui ne compte aujourd’hui que 12 % d’œuvres réalisées par des femmes.
Sans prétendre à l’exhaustivité ni rendre compte de l’amplitude de l’histoire de l’art des femmes, l’exposition propose un parcours sélectif où chaque œuvre présentée est reliée à une année précise et à l’une des trois sections qui en orientent la lecture.
La première section retrace les choix esthétiques et plastiques des femmes artistes à travers l’histoire de l’art. La seconde rend compte de certaines transformations majeures entourant les conditions sociales des femmes, ainsi que l’engagement politique des artistes du Québec et d’ailleurs. La troisième dresse quant à elle une histoire des femmes propre au MAJ.
Certaines œuvres sont insérées en fonction de leur année de création alors que d’autres sont rattachées à un événement externe, tel qu’une manifestation politique, une exposition importante ou le moment de leur acquisition. Cette mise en contexte permet de jeter un regard élargi sur les œuvres tenant compte à la fois de l’entremêlement du social, de l’esthétique et du politique.
À partir d’œuvres de tout acabit, allant d’études préparatoires à des œuvres de fin de carrière, l’exposition rend visibles des récits parfois méconnus. En révélant des aspects sous-représentés et des absences, les recherches menées contribueront à éclairer le développement de la collection du MAJ pour les années à venir vers une représentation encore plus riche et diversifiée de la production des femmes artistes.
Si les femmes ont pris du galon à travers le temps, c’est qu’elles se sont engagées pour faire reconnaître leur valeur et dénoncer les iniquités à leur égard. La population s’est mobilisée et des femmes se sont regroupées pour acquérir une force collective, tant dans la sphère sociopolitique que dans le domaine des arts. Elles ont su faire changer les perceptions et prendre leur place. Cette exposition ainsi que l’histoire de la collection dévoilée mettent en lumière ce travail collectif mené au fil du temps pour célébrer l’art au féminin, chantier toujours en cours, car rien ne doit être tenu pour acquis.
Exposition permanente.
Pour plus d'infos, cliquez.
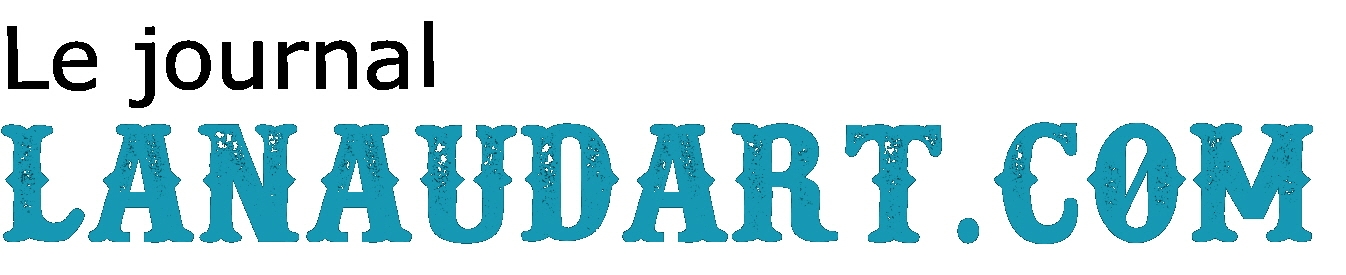
Le guide bimensuel des arts et de la culture de Lanaudière
Dans sa neuvième année! / 157e édition
Accueil|Ce mois-ci|Bientôt|Expositions / Littérature|Actualités|Portraits|Ciné-appréciations
Suivez-nous
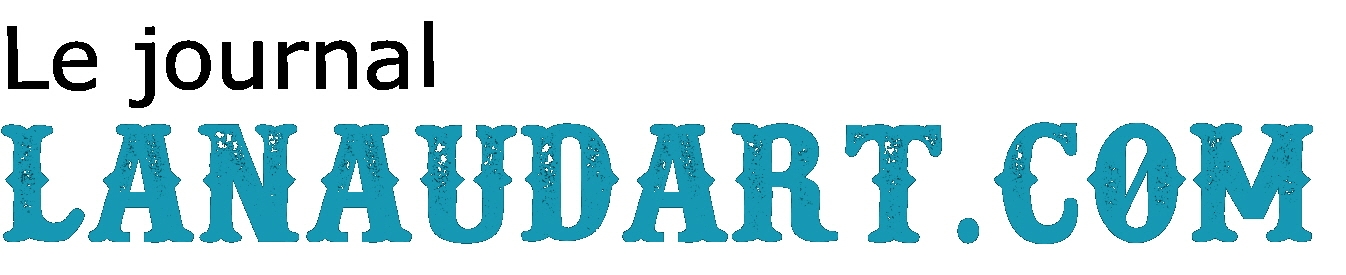
Le guide bimensuel des arts et de la culture de Lanaudière
Dans sa neuvième année! / 157e édition
Accueil|Ce mois-ci|Bientôt|Expositions / Littérature|Actualités|Portraits|Ciné-appréciations
© 2017-2026 Les éditions Pommamour.
Tous droits réservés.
Politique de confidentialité